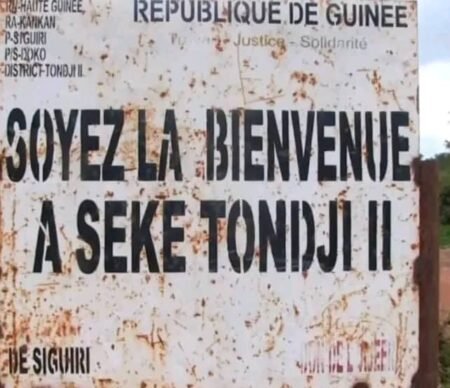« La justice sénégalaise est l’un de nos plus gros problèmes. » Cette affirmation sentencieuse et comminatoire n’a pas été prononcée par un opposant sénégalais. C’est Ousmane Sonko, l‘actuel Premier ministre sénégalais qui a tenu ces propos, début juillet à Dakar, suite à la récente décision de la Cour suprême de son pays.
L’instance judiciaire la plus élevée du Sénégal, le plus haut tribunal du pays qui statue en dernier ressort sur les recours en cassation, ainsi que sur les questions de légalité des actes administratifs et des décisions des collectivités locales, a en effet rejeté le recours d’Ousmane Sonko contre sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour diffamation et 300 millions de FCFA d’amende.
Ce contentieux judiciaire, qui remonte aux années où l’actuel leader du groupe des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) était dans l’opposition, fait suite à une plainte jadis déposée contre l’opposant par l’ex-ministre du Tourisme de Macky Sall, Mame Niang.
Horizon politique assombri
Cette décision de justice, qui n’est pas susceptible de recours, qui est donc définitive et sans appel, assombrit l’horizon politique d’Ousmane Sonko, alors qu’il pourrait légitimement prétendre à l’investiture de sa formation politique lors de la prochaine élection présidentielle de 2029, à l’issue du mandat de l’actuel chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.
Si certains avis autorisés parmi des juristes sénégalais estiment que cette affaire est bouclée et qu’il n’existe plus de possibilité pour Ousmane Sonko de voir son honneur lavé par la justice de son pays, le Premier ministre a estimé de son côté, dans une formule mystérieuse et sibylline, que « l’affaire n’est pas finie ».
Ses avocats ont par ailleurs annoncé leur intention de saisir le ministre de la Justice aux fins d’obtenir une réouverture du procès de l’ancien opposant virulent à Macky Sall. Car, arguent-ils, il s’était alors agi d’un procès politique afin de disqualifier la candidature du bouillant leader du PASTEF à l’élection présidentielle à venir.
C’est d’ailleurs consécutivement à l’une de ces condamnations qu’Ousmane Sonko ne put se présenter à l’élection présidentielle de 2024, alors que ses chances de victoire étaient considérables, voire incontestables. Il dut faire contre mauvaise fortune bon cœur et, dans l’intérêt supérieur du PASTEF, prépara discrètement Bassirou Diomaye Faye en guise de plan B.
Il fut confortablement élu dès le premier tour.
L’épisode judiciaire actuel n’est cependant pas un épiphénomène.
Au plan politique, il fait peser, une fois de plus, une épée de Damoclès sur une prochaine candidature d’Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle. Si cette échéance demeure lointaine, il y a néanmoins lieu de reconnaître que les sorties récentes du leader du PASTEF contre la justice sénégalaise questionnent.
Comme dans nombre de pays africains et en dépit des déclarations de principe et de la façade démocratique de nombreux régimes, certains juges sont très souvent instrumentalisés pour neutraliser des adversaires politiques, lorsqu’il ne s’agit pas tout simplement de les exclure arbitrairement de la compétition pour l’accession à la magistrature suprême.
Ousmane Sonko conserve à n’en pas douter en travers de la gorge cette séquence frustrante et dramatique de sa carrière politique.
Courage intellectuel des juges
Toutefois, il importe à la vérité de reconnaître que, sur un tout autre plan, la justice sénégalaise – notamment les juges constitutionnels – a rendu au pays de l’éminent juriste Kéba Mbaye, de regrettée mémoire, ses lettres de noblesse à l’occasion de la dernière élection présidentielle.
Le courage intellectuel des juges constitutionnels sénégalais, leur probité, leur sens de l’éthique républicaine auront été décisifs pour parvenir à un épilogue apaisé à l’occasion de la dernière élection présidentielle au Sénégal.
L’opposition des sages du Conseil constitutionnel à la tentative de Macky Sall de repousser le moment de son départ du pouvoir aura préservé le Sénégal de mouvements de contestation, voire de débordements aux conséquences imprévisibles pour la paix civile et la stabilité du pays.
Précédent dangereux
Pour en revenir à la décision des avocats d’Ousmane Sonko de saisir le Garde des Sceaux afin d’obtenir une réouverture du procès, elle pourrait créer un précédent dangereux pour l’indépendance de la justice si elle venait à connaître une suite favorable. De par sa position hiérarchique, le ministre de la Justice est dans une position de subordination par rapport au Premier ministre, chef du Gouvernement.
Comment la réouverture de ce procès ne donnerait-elle pas du grain à moudre à ceux qui, à tort ou à raison, crieraient au scandale judiciaire ou dénonceraient une justice aux ordres et à la tête du client ? Quels arguments pourrait-on opposer à ceux qui verraient dans ce retour à la case départ une décision dictée par l’ascendant du chef du Gouvernement sur son ministre de la Justice ?
Le contexte politique et judiciaire d’une éventuelle décision de cette nature serait du plus mauvais effet alors que la dépénalisation des délits de presse demeure attendue par la presse sénégalaise. Or, le récent emprisonnement du chef de cabinet de Macky Sall, jugé excessif par de nombreux observateurs, laisse planer des soupçons d’instrumentalisation de la justice par le nouveau pouvoir de Dakar. Tout comme l’arrestation du chroniqueur télé Badara Gadiaga, qui a été placé en garde à vue le mercredi 9 juillet « pour discours contraire aux bonnes mœurs », après s’être exprimé au cours d’un débat télévisé sur le procès qui a opposé, il y a quelques années, Ousmane Sonko, alors opposant, à la masseuse Adji Sarr qui l’accusait de viol.
La justice demeure le baromètre des libertés et des droits fondamentaux dans une démocratie. Pour un Sénégal cité en exemple pour la conduite de son processus démocratique en Afrique subsaharienne francophone, les nouvelles autorités sénégalaises ont tout à gagner à préserver la noble réputation de leur pays.
Éric Topona Mocnga
Journaliste à la rédaction francophone de la Deutsche Welle, à Bonn (Allemagne)
Lire l’article original ici.